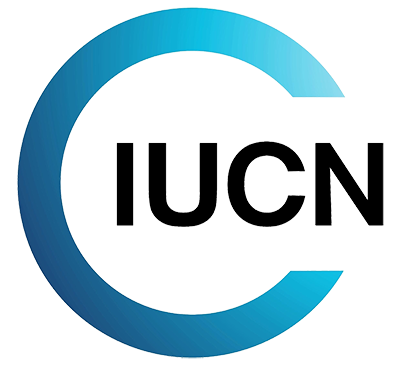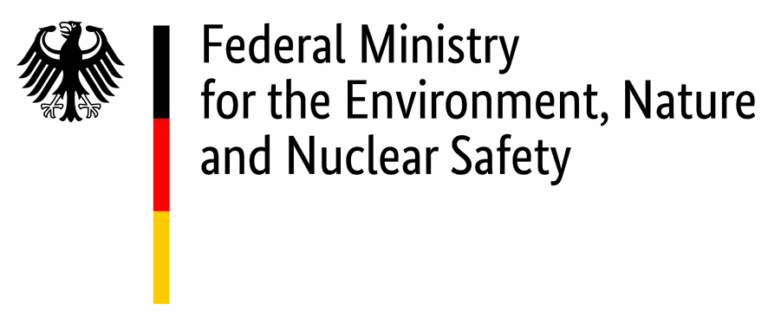Abe Outils De Navigateur
Le navigateur d'outils EbA, développé par les partenaires IIED, UNEP-WCMC, UICN et GIZ, compile des outils et des méthodologies sur l'EbA pour aider les praticiens et les décideurs à mettre en œuvre et à intégrer efficacement l'EbA dans la planification de l'adaptation au climat.
Le navigateur est une base de données consultable d'outils et de méthodes relatifs à l'EbA, qui fournit des informations pratiques sur plus de 240 outils, méthodologies et documents d'orientation. Les outils présentés couvrent un large éventail de sujets, notamment la planification et les évaluations, la mise en œuvre et l'évaluation, le suivi et l'intégration.
Il a été conçu pour aider les utilisateurs à trouver les outils et méthodes les plus appropriés pour soutenir leur travail et les mettre en pratique. Des informations détaillées sont fournies sur chaque outil et sur la manière de l'appliquer. Les utilisateurs peuvent également ajouter des informations sur les nouveaux outils non encore inclus, ainsi que leurs propres expériences dans l'application d'outils particuliers pour l'EbA.
Les membres de la FEBA ont fourni des commentaires et des évaluations précieux sur les premières versions du Navigator.
Agriculture « climatiquement intelligente » : Politiques, pratiques et financement pour la sécurité alimentaire, l’adaptation et l’atténuation présente un éventail de pratiques, d’approches et d’outils visant à accroître la résilience et la productivité des systèmes de production agricole, tout en réduisant et en éliminant les émissions. La deuxième partie de l’article examine les options institutionnelles et politiques disponibles pour promouvoir la transition vers une agriculture climato-intelligente au niveau des petits exploitants. Enfin, l’article examine les déficits de financement actuels et formule des suggestions innovantes concernant l’utilisation combinée de différentes sources, mécanismes de financement et systèmes de distribution.
Examiner certaines des principales réponses techniques, institutionnelles, politiques et financières nécessaires pour parvenir à une transformation vers une agriculture intelligente face au climat.
Aucune ressource supplémentaire n'est requise.
Aucune compétence/formation supplémentaire n'est requise.
Une évaluation comparative des outils d'aide à la décision pour la quantification et l'évaluation des services écosystémiques est un article de recherche qui décrit 17 outils de services écosystémiques et évalue leurs performances selon huit critères d'évaluation permettant d'évaluer leur aptitude à une application généralisée dans les processus décisionnels des secteurs public et privé. Il décrit les utilisations prévues de chaque outil, les services modélisés, les approches analytiques, les besoins en données et les résultats, ainsi que le temps nécessaire à l'exécution de sept outils lors d'une première application simultanée comparative de plusieurs outils sur un site commun : le bassin versant de la rivière San Pedro, dans le sud-est de l'Arizona (États-Unis), et le nord de Sonora (Mexique). Sur la base de ces travaux, l'article propose des conclusions sur l'aptitude actuelle de ces outils à une application généralisée dans les processus décisionnels des secteurs public et privé. Enfin, il décrit les pistes potentielles pour réduire les besoins en ressources nécessaires à l'exécution des modèles de services écosystémiques, essentiels à une utilisation plus large dans la prise de décision environnementale.
Fournir un aperçu et une évaluation des performances de différents outils de services écosystémiques.
Aucun logiciel/ressource supplémentaire n'est nécessaire.
Aucune compétence spécifique spécifiée.
Un guide pratique pour l'adaptation communautaire propose un système d'activités modulaires permettant aux équipes de terrain d'élaborer et de mettre en œuvre des projets d'adaptation au changement climatique réussis, cogérés et soutenus par les communautés. Basées sur des années d'utilisation dans 129 pays, les techniques présentées dans ce guide pratique proposent une progression étape par étape pour guider les lecteurs à travers l'évaluation des problèmes, la conception, la mise en œuvre et la prise en charge par la communauté. Cet ouvrage fournit aux équipes de développement tous les outils et techniques nécessaires pour améliorer l'efficacité des projets en cours, intégrer l'adaptation communautaire dans la programmation organisationnelle et générer de nouveaux projets. Les techniques présentées peuvent être appliquées à un large éventail de défis, allant de l'agriculture aux problèmes liés aux sols et à l'eau, en passant par les préoccupations sanitaires, la protection contre les inondations et le développement des marchés.
Aider les praticiens à développer et à mettre en œuvre des projets d’adaptation au changement climatique réussis qui peuvent être cogérés et soutenus par les communautés.
Le temps et les ressources nécessaires pour entreprendre le processus dépendent du choix des outils, du degré d’engagement des parties prenantes, de la collecte, de la préparation et de l’analyse des données.
Des compétences variées seront nécessaires pour accomplir des tâches telles que la collecte de données, l'analyse des intrants et des résultats, la planification et la communication. Des compétences en animation et une expérience de travail avec les communautés seraient un atout.
Le rapport « Cadre d'évaluation de la vulnérabilité des communautés forestières au changement climatique » décrit un cadre général et une approche permettant d'évaluer la vulnérabilité des communautés forestières au changement climatique et les risques potentiellement accrus qui y sont associés. Il identifie les éléments spécifiques à prendre en compte dans l'évaluation de la vulnérabilité et décrit une série d'étapes que les chercheurs ou une communauté peuvent suivre pour déterminer systématiquement les sources de vulnérabilité au changement climatique.
`
Le temps et les ressources nécessaires pour entreprendre le processus dépendent de l’ampleur du projet/programme, du degré d’engagement des parties prenantes, de la collecte et de la validation des données, de la préparation et de l’analyse.
Des compétences variées seront nécessaires pour accomplir des tâches telles que la collecte de données, l'analyse des intrants et des résultats, la planification et la communication. Des compétences en animation et une expérience de travail avec les communautés seraient un atout.
Un cadre d'évaluation du retour sur investissement dans les systèmes de terres arides du nord du Kenya est un document de travail qui présente un cadre d'évaluation permettant de pondérer la valeur économique totale des services écosystémiques fournis par les systèmes pastoraux et mixtes d'utilisation des terres dans un contexte de changements et de variabilité climatiques anticipés. Il présente un processus en quatre étapes et propose des outils utiles pour chaque étape.
Stimuler et contribuer à une discussion sur la manière dont les rendements des investissements fonciers dans les zones arides devraient être évalués.
Le temps et les ressources nécessaires pour entreprendre le processus dépendent de l’ampleur du projet/programme, du degré d’engagement des parties prenantes, de la collecte et de la validation des données, de la préparation et de l’analyse.
Des connaissances et des compétences en évaluation des écosystèmes ainsi qu'en SIG sont nécessaires. Selon la disponibilité des ressources, du temps, des jeux de données et de l'expertise, le processus peut produire une gamme variée allant d'évaluations participatives schématiques très simples à des exercices de modélisation plus complexes.
La Boîte à outils pour accroître la résilience au changement climatique est une compilation d'outils et de méthodologies permettant d'intégrer les composantes du cadre de résilience aux stratégies locales et nationales, de manière pleinement participative, pour une plus grande résilience des communautés locales face aux changements climatiques et aux autres changements mondiaux. Elle illustre les flux d'activités de chaque étape pratique et montre comment ces différentes étapes sont interconnectées pour mettre en place des plans d'adaptation au changement climatique intégrés et plus résilients, tels que des zones humides, des plaines inondables et des mangroves qui stockent l'eau, réduisent les pics de crue ou protègent les communautés côtières.
L'objectif de cette boîte à outils est de fournir des orientations et des recommandations sur la manière d'élaborer des stratégies et des plans de résilience au changement climatique aux niveaux national, infranational et local. Concrètement, cette boîte à outils vise à accompagner tous ceux qui participent à la conception d'initiatives de résilience mesurables, vérifiables et déclarables dans les quatre principaux secteurs que sont l'agriculture, l'eau, l'écologie et le social, en fournissant des conseils étape par étape.
Le temps et les ressources nécessaires pour entreprendre le processus dépendent de l’ampleur du projet/programme, du degré d’engagement des parties prenantes, de la collecte et de la validation des données, de la préparation et de l’analyse.
Une gamme d’expertise sera nécessaire pour accomplir des tâches telles que la collecte de données, l’analyse des entrées/résultats, la planification et la communication.
Le Manuel de mesure des progrès et des résultats de la gestion intégrée des zones côtières et océaniques présente une série d'indicateurs environnementaux permettant de suivre l'état du milieu côtier et marin, ainsi que des indicateurs socioéconomiques et de gouvernance. Ces indicateurs sont alignés sur les objectifs de la gestion intégrée des zones côtières et océaniques. Il décrit également une approche pour tester les indicateurs sélectionnés et fournit des exemples d'indicateurs intégrés à divers cadres d'évaluation, tels que les cadres logiques.
Contribuer au développement durable des zones côtières et marines en promouvant une approche plus axée sur les résultats, responsable et adaptative de la gestion intégrée des zones côtières et océaniques.
Aucun logiciel/ressource supplémentaire n'est nécessaire.
Aucune compétence spécifique spécifiée.
Ce rapport de réunion du Groupe spécial d'experts techniques sur les indicateurs présente une série d'indicateurs pouvant être adoptés pour mesurer la performance autour de quatre questions clés : Comment évolue l'état de la biodiversité ? (état) ; Pourquoi perdons-nous de la biodiversité ? (pressions et causes sous-jacentes) ; Quelles sont les implications ? (avantages) ; et Que faire ? (réponses). Un fichier Excel intégré fournit des informations complémentaires sur les indicateurs, notamment leur échelle, leur validité scientifique, leur facilité de communication, les exigences en matière de données et des précisions sur les organismes chargés de la mesure.
Fournir des informations sur les indicateurs de biodiversité et sur leur utilisation possible.
Aucun logiciel/ressource supplémentaire n'est nécessaire.
Aucune compétence spécifique spécifiée.
Adaptation Compass est un outil d'orientation (aux formats Excel et PDF) permettant d'évaluer la vulnérabilité et les options d'adaptation dans différents secteurs des zones urbaines (à l'échelle d'une région, d'une ville ou d'un projet). Il applique une structure d'évaluation et de documentation pré-structurée, permettant à l'utilisateur de planifier les étapes d'adaptation pour créer des villes à l'épreuve du climat. L'outil fournit des informations générales et des réponses automatisées. Il offre également la possibilité de soumettre des informations locales.
Aider les planificateurs et les experts des villes et des conseils des eaux à structurer les étapes de travail, fournir des exemples de bonnes pratiques et mettre en évidence les problèmes et les obstacles possibles.
Aucun logiciel ni ressource supplémentaire n'est requis pour utiliser cet outil. Des ressources doivent déjà être en place pour faciliter le processus d'adaptation. Un document d'orientation et des études de cas d'adaptation sont fournis. Le temps nécessaire à la mise en œuvre du processus/des évaluations dépend de l'ampleur de la collecte, de la préparation et de l'analyse des données.
Destiné aux professionnels de l'urbanisme et de la gestion de l'eau. Une connaissance des impacts et des politiques du changement climatique serait un atout.
Les neuf pratiques de la Liste de contrôle des bonnes pratiques d'adaptation (PGA) définissent l'éventail des domaines d'activité nécessaires à l'adaptation au changement climatique. Elles sont issues d'une synthèse des expériences pratiques en Afrique, des documents de la CCNUCC et du Fonds vert pour le climat sur la planification, le financement, les lacunes, les changements de paradigme et les garanties environnementales et sociales de l'adaptation. Cette liste de contrôle appuie la conception, les décisions, le renforcement des capacités, la mise en œuvre et le suivi de l'adaptation, en lien avec le déploiement des Contributions déterminées au niveau national (CDN), des Plans nationaux d'adaptation (PNA) et du financement de l'adaptation. Elle peut servir à éclairer ou à examiner les concepts, les propositions, les plans de mise en œuvre et les budgets nationaux afin de vérifier leur intégration et leur conformité aux bonnes pratiques d'adaptation, et à déterminer les axes de recherche et de renforcement des capacités.
Fournir aux utilisateurs des conseils sur les actions et les critères qui contribuent à garantir que l’adaptation se traduit par une résilience climatique de qualité, efficace et à long terme pour les personnes les plus vulnérables.
Le temps et les ressources nécessaires pour entreprendre le processus dépendent de l’ampleur du projet/programme, du degré d’engagement des parties prenantes, de la collecte et de la validation des données, de la préparation et de l’analyse.
Une gamme d’expertise sera nécessaire pour accomplir des tâches telles que la collecte de données, l’analyse des entrées/résultats, la planification et la communication.
Le Guide de l'adaptation sur mesure présente une approche en cinq étapes pour la conception de projets d'adaptation et de systèmes de suivi axés sur les résultats. Il offre des conseils pratiques pour répondre aux questions « Qu'est-ce qui caractérise un projet d'adaptation ? » et « Comment mesurer les résultats de l'adaptation ? ». Il constitue également une source de référence pour les organisations nationales et internationales, les ONG et les organismes de recherche qui recherchent un cadre pratique pour la conception axée sur les résultats des interventions d'adaptation et la vérification des résultats obtenus. Cette nouvelle édition du guide a été entièrement mise à jour en novembre 2013. Elle est accompagnée d'un outil Excel (outil MACC) et d'un référentiel d'indicateurs d'adaptation.
Servir d’aide à la conception et au suivi des projets d’adaptation pour le personnel de la GIZ et les représentants des gouvernements, d’autres donateurs bilatéraux et multilatéraux et des ONG engagés dans la planification et la mise en œuvre de projets d’adaptation.
Aucune ressource supplémentaire n'est requise.
Aucune compétence spécifique spécifiée.
L'outil de projet d'adaptation fournit des conseils axés sur le Pacifique sur la définition, le développement et la planification des projets d'adaptation au changement climatique, notamment en aidant les utilisateurs à accéder aux ressources et à élaborer des notes conceptuelles de projet et des propositions de projet préliminaires.
Fournir des conseils pour l'élaboration et la planification de projets liés au changement climatique, au développement résilient et à la réduction des risques de catastrophe. Cet outil est destiné aux planificateurs et aux praticiens des comtés des îles du Pacifique et d'autres organismes souhaitant développer des projets intégrant la prise en compte du changement climatique et de la réduction des risques de catastrophe.
Aucun logiciel/ressource supplémentaire n'est nécessaire.
Aucune compétence spécifique spécifiée.
L'Outil d'Aide à l'Adaptation est un outil en ligne composé de six étapes qui, ensemble, aident l'utilisateur à explorer les risques et la vulnérabilité au climat actuel et futur, à identifier et évaluer les options d'adaptation, à élaborer et mettre en œuvre une stratégie et/ou un plan d'action d'adaptation au changement climatique, et à suivre ses résultats. Chaque étape de l'Outil d'Aide à l'Adaptation comprend une introduction générale et plusieurs sections d'aide plus détaillées. Il est recommandé aux utilisateurs de lire attentivement l'introduction de chaque étape avant de l'examiner en détail ou de passer à l'étape suivante. L'Outil d'Aide à l'Adaptation ne permet pas de créer une stratégie d'adaptation climatique sur mesure en un clic. Il vise plutôt à mettre en évidence les points clés à prendre en compte lors de la planification et de la mise en œuvre de l'adaptation et donne accès à des informations, des outils et des ressources pertinents.
Aider les utilisateurs à élaborer des stratégies et des plans d’adaptation au changement climatique en fournissant des conseils, des liens vers des sources pertinentes et des outils dédiés.
Aucune ressource supplémentaire n'est requise.
Aucune compétence spécifique spécifiée.
Adaptation au changement climatique en agriculture : Évaluation des options propose un cadre pour évaluer de manière cohérente et systématique les options d’adaptation au changement climatique en agriculture. Ce document examine les approches d’évaluation des options d’adaptation au changement climatique ; démontre l’applicabilité du cadre à l’adaptation agricole au moyen d’études de cas ; et identifie les contraintes et opportunités importantes pour intégrer les adaptations au climat dans la prise de décision agricole.
Informer les parties prenantes du gouvernement, du milieu de la recherche, de l’industrie agricole et agroalimentaire, des organisations agricoles et du grand public sur l’évaluation des mesures d’adaptation disponibles dans l’agriculture pour faire face aux risques liés au climat.
Aucun logiciel/ressource supplémentaire n'est nécessaire.
Aucune compétence spécifique spécifiée.
L'adaptation au changement climatique dans la gestion des prairies examine les options d'adaptation pour traiter les principaux domaines de vulnérabilité des prairies au changement climatique (identifiés dans Thorpe 2011), notamment :
– Déplacements dans les zones de végétation, avec des implications pour la couverture ligneuse, la structure des prairies et les types photosynthétiques
– Évolution de la productivité moyenne des prairies
– Augmentation de la fréquence des années de sécheresse avec une faible productivité
– Changements dans la biodiversité, y compris la migration de nouvelles espèces et l’émergence de nouvelles communautés
– Risque accru d’invasion exotique
– Perte de zones humides
Pour accroître la résilience des prairies.
Aucune ressource supplémentaire n'est requise.
Aucune compétence/formation supplémentaire n'est requise.
La trousse d’outils d’adaptation : Élévation du niveau de la mer et utilisation des terres côtières fournit un aperçu concis d’une gamme d’outils de planification, de réglementation et de dépenses pour aider à la prise de décision en matière d’adaptation.
Aider les gouvernements à déterminer les outils à utiliser pour répondre à leurs contextes socio-économiques et politiques uniques.
Aucun logiciel/ressource supplémentaire n'est nécessaire.
Aucune compétence spécifique spécifiée.
La Boîte à outils d'adaptation : Guide à l'intention des praticiens de l'adaptation communautaire couvre les domaines suivants de l'adaptation au changement climatique : cartographie des ressources ; cartographie des capacités et des actifs ; analyse des tendances et profil historique des perturbations ; cartographie de la vulnérabilité actuelle ; perceptions du changement climatique ; élaboration participative de scénarios et rétrospective ; sélection des mesures d'adaptation ; et recherche locale : bonnes pratiques. Pour chaque thème, la boîte à outils présente une brève description, ainsi que des conseils sur les objectifs, les résultats attendus, les ressources et les activités.
Contribuer à l'évaluation de la vulnérabilité au changement climatique et à l'élaboration de stratégies d'adaptation fondées sur les capacités actuelles. Plus précisément, les chercheurs seront capables d'identifier les capacités, les compétences et les atouts actuels sur le site d'un projet, de comprendre les événements climatiques passés et les stratégies d'adaptation utilisées, ainsi que les aléas climatiques et environnementaux actuels qui influencent la vulnérabilité ; et, sur cette base, de faciliter un processus multipartite pour l'élaboration de stratégies d'adaptation adaptées au contexte local.
Le temps nécessaire à la mise en œuvre du processus dépend de l'ampleur de la collecte, de la préparation et de l'analyse des données. Cependant, lors des tests sur le terrain, les activités ont été menées lors d'un atelier de trois jours avec les membres de la communauté.
Des compétences en animation seront nécessaires, ainsi qu'une compréhension de base du changement climatique, de l'utilisation des ressources naturelles et de la vulnérabilité socio-économique. Une équipe pluridisciplinaire serait un atout.
AdaptationCommunity.net a été développé à l'intention du public intéressé et des experts en adaptation afin de fournir des informations sur l'application d'approches, de méthodes et d'outils facilitant la planification et la mise en œuvre des mesures d'adaptation. De plus, l'amélioration des connaissances et le partage d'expériences sont essentiels à la réussite des stratégies d'adaptation. Cette plateforme offre donc une mine d'informations, des webinaires et des formations sur huit thèmes clés : informations et services climatiques ; évaluation de la vulnérabilité ; intégration et planification nationale de l'adaptation (PNA) ; PNA et contributions déterminées au niveau national (CDN) ; adaptation écosystémique ; gestion des risques climatiques ; adaptation du secteur privé ; et suivi-évaluation.
Fournir au public et aux experts en adaptation des informations sur l’application d’approches, de méthodes et d’outils qui facilitent la planification et la mise en œuvre des mesures d’adaptation.
Aucune ressource supplémentaire n'est requise.
Aucune compétence spécifique spécifiée.
Ce manuel d’orientation sur l’adaptation est conçu pour aider les planificateurs et les parties prenantes à identifier et à analyser les options d’adaptation grâce à une approche par étapes s’appuyant sur des études de cas pertinentes.
Intégrer la vulnérabilité et l’adaptation dans la conception des projets en fournissant des conseils sur le dépistage de la vulnérabilité, l’identification des options d’adaptation, la réalisation des analyses nécessaires, la sélection des réponses appropriées et la mise en œuvre et l’évaluation de ces réponses.
Le temps nécessaire à la mise en œuvre du processus dépend de la portée de l'initiative, des analyses associées, du nombre d'acteurs impliqués et de la quantité d'informations complémentaires/secondaires disponibles dans la zone cible. Aucun logiciel ni ressource supplémentaire n'est requis.
La connaissance des changements climatiques actuels et futurs et de leur lien avec le projet sera bénéfique.
Ce guide d’adaptation côtière propose une approche pour évaluer la vulnérabilité au changement climatique et à la variabilité climatique, développer et mettre en œuvre des options d’adaptation et intégrer ces options dans les programmes, les plans de développement et les projets aux niveaux national et local.
Pour aider les utilisateurs :
- Évaluer la vulnérabilité
- Définir les objectifs d'adaptation et sélectionner les mesures
- Adaptation côtière générale
- Mettre en œuvre l'adaptation
- Évaluer pour une gestion adaptative
Le temps nécessaire à la mise en œuvre du processus dépend de la portée de l'initiative, des analyses associées, du nombre d'acteurs impliqués et de la quantité d'informations complémentaires/secondaires disponibles dans la zone cible. Aucun logiciel ni ressource supplémentaire n'est requis.
La connaissance des changements climatiques actuels et futurs et de leur lien avec le projet sera bénéfique.
Le Guide technique de gestion adaptative aborde quatre questions fondamentales concernant la gestion adaptative : (1) Qu'est-ce que la gestion adaptative ? (2) Quand faut-il l'utiliser ? (3) Comment faut-il la mettre en œuvre ? (4) Comment son succès peut-il être reconnu et mesuré ? La structure du guide s'articule autour de ces questions clés, chacune étant abordée dans des chapitres distincts.
Présenter une définition opérationnelle de la gestion adaptative, identifier les conditions dans lesquelles la gestion adaptative doit être envisagée et décrire le processus d’utilisation de la gestion adaptative pour la gestion des ressources naturelles.
Aucun logiciel/ressource supplémentaire n'est nécessaire.
Aucune compétence spécifique spécifiée.
La méthodologie MARISCO vise à faciliter l'intégration de la perspective risque et vulnérabilité dans la gestion des projets et sites de conservation. Elle vise à garantir la prise en compte de l'impact du changement climatique dans la gestion stratégique des aires protégées, sans toutefois s'y limiter. Elle a été développée en coopération avec la GIZ et le HNE Eberswalde lors d'ateliers et de projets en Allemagne, en Ukraine, en Chine, au Guatemala et au Pérou.
Faciliter l’intégration d’une perspective dynamique de risque et de vulnérabilité dans la gestion des projets et des sites de conservation.
Le temps nécessaire pour entreprendre le processus dépend de l’étendue de la collecte, de la préparation et de l’analyse des données.
Des ateliers de formation sont recommandés pour se familiariser avec la méthode.
Cette boîte à outils vous fournit un certain nombre d'outils et d'exercices, et propose
lectures complémentaires sur des sujets choisis. Il soutient ainsi la mise en œuvre de la
Note d'orientation « Faire face aux risques liés à la fragilité climatique » qui facilite la
élaboration de stratégies, de politiques et de projets visant à accroître la résilience
en reliant l'adaptation au changement climatique, la consolidation de la paix et le développement durable
moyens de subsistance. Chaque outil et exercice est expliqué en détail. Des outils plus complexes sont
décomposé en étapes individuelles.
Elle soutient ainsi la mise en œuvre de la
Note d'orientation « Faire face aux risques liés à la fragilité climatique » qui facilite la
élaboration de stratégies, de politiques et de projets visant à accroître la résilience
en reliant l'adaptation au changement climatique, la consolidation de la paix et le développement durable
moyens de subsistance.
ALivE est un outil informatique conçu pour aider ses utilisateurs à organiser et analyser les informations afin de planifier des options d'adaptation écosystémique efficaces dans le cadre d'un processus de planification plus large. ALivE signifie Adaptation, Moyens de subsistance et Écosystèmes. Il s'agit d'une technique d'évaluation qualitative rapide, applicable à tout écosystème.
Pour aider les utilisateurs :
- Comprendre et analyser les liens entre les écosystèmes, les moyens de subsistance et le changement climatique.
- Identifier et prioriser les options EbA pour la résilience des communautés et des écosystèmes.
- Concevoir des activités de projet qui facilitent la mise en œuvre des options prioritaires de l’EbA.
- Identifier les éléments clés et les indicateurs d’un cadre de suivi et d’évaluation (S&E).
ALivE est une analyse informatisée qui s'appuie sur des informations recueillies lors de recherches documentaires et participatives. Le temps nécessaire à la collecte des informations varie et dépend largement de la portée de l'analyse, de la quantité d'informations déjà disponibles sur la zone cible et des relations existantes avec les acteurs locaux. Une fois toutes les informations collectées, l'utilisation d'ALivE ne prend généralement que quelques jours.
Les utilisateurs devront disposer d'un ordinateur et d'une connexion internet pour télécharger l'outil. Cependant, l'outil lui-même peut être utilisé hors ligne. L'accès aux informations et analyses existantes sur les écosystèmes, les moyens de subsistance et le changement climatique dans la zone cible permettra d'alimenter l'outil. Une expertise en adaptation au changement climatique et en restauration, conservation et gestion des écosystèmes est utile, mais pas obligatoire.
Une boîte à outils de 30 pages qui présente 16 fiches d’intervention spécifiques pour permettre au décideur d’évaluer, d’évaluer et de choisir les interventions les plus appropriées pour résoudre les problèmes identifiés dans son bassin versant.
Le CFF a compilé cette boîte à outils pour guider les praticiens, les décideurs et les responsables politiques, ainsi que toute personne intéressée par les infrastructures écologiques, sur la manière d’améliorer la santé globale des rivières.
Aucune connaissance spécialisée n'est requise
Aucune compétence spécifique n'est requise pour utiliser l'outil
Ce guide d'introduction à l'évaluation des services écosystémiques propose une introduction pratique aux étapes clés de l'évaluation des services écosystémiques dans le contexte de l'évaluation des politiques. Il adopte une approche par chemins d'impact pour évaluer les services écosystémiques. Il s'appuie sur les approches d'évaluation traditionnelles. Le chapitre 3 présente notamment les étapes à suivre pour évaluer les impacts sur les services écosystémiques, notamment l'identification des options politiques et du niveau de référence actuel ; l'évaluation de l'impact des options politiques sur la fourniture des services écosystémiques et l'évaluation des changements dans ces services.
Fournir à l’utilisateur une introduction à l’évaluation des services écosystémiques.
Le temps nécessaire pour entreprendre le processus dépend de l’étendue de la collecte, de la préparation et de l’analyse des données.
Aucune compétence particulière n'est requise. Ce guide d'introduction s'adresse à un large public et propose donc des résumés non techniques pour chaque chapitre, même si certaines sections sont nécessairement de nature technique.
Le Suivi de l'Adaptation et Mesure du Développement (TAMD) répond au besoin de cadres d'évaluation permettant d'évaluer l'efficacité relative (ou comparative) des interventions visant directement et/ou indirectement l'adaptation au changement climatique. Bien que TAMD ait été développé dans le cadre du Fonds international pour le climat (FIC), l'objectif est de fournir un cadre suffisamment pratique, flexible et transparent pour être appliqué ou adapté à une grande variété de contextes et à différentes échelles, du national (et supranational) au local. L'article identifie des indicateurs spécifiques utilisables avec TAMD et aborde plusieurs défis liés à l'évaluation de l'adaptation, notamment la nécessité d'établir des bases de référence, la manière dont les données peuvent être collectées et comment les théories du changement et les données empiriques peuvent, ensemble, contribuer à l'attribution des résultats aux interventions d'adaptation. Enfin, une liste de contrôle pour l'application de TAMD est présentée.
Décrire les étapes nécessaires à l’application du cadre de suivi de l’adaptation et de mesure du développement (TAMD), en fournissant des conseils pratiques sur la manière de mettre en œuvre les concepts décrits dans le document de travail n° 1 de l’IIED sur le changement climatique (Brooks et al., 2011).
Le temps et les ressources nécessaires pour entreprendre le processus dépendent du choix des outils, du degré d’engagement des parties prenantes, de la collecte, de la préparation et de l’analyse des données.
Une gamme d’expertise sera nécessaire pour accomplir des tâches telles que la collecte de données, l’analyse des entrées/résultats, la planification et la communication.
Le guide « Approche pour le reporting des services écosystémiques » traduit les réflexions émergentes sur les services écosystémiques en indicateurs de reporting de durabilité et présente des approches utilisables par les organisations de tous secteurs. Bien que centré sur les organisations, ce guide propose une introduction aux services écosystémiques et aux approches d'évaluation, notamment des critères de conception des indicateurs.
Fournir une introduction aux services écosystémiques et aux approches d’évaluation, y compris les critères de conception des indicateurs.
Aucun logiciel/ressource supplémentaire n'est nécessaire.
Aucune compétence spécifique spécifiée.
ARIES est une application logicielle qui facilite l'évaluation et la valorisation des services écosystémiques. Elle construit des modèles d'offre et de demande de services écosystémiques à partir de modèles de composants stockés et simule spatialement le flux dynamique des bénéfices. Elle s'adapte à différentes échelles et utilise différentes formes de données d'entrée, unités de mesure et paradigmes de modélisation.
Permettre la prise en compte des services écosystémiques dans le processus de prise de décision en permettant à l’utilisateur de : cartographier les zones importantes pour les services écosystémiques et la biodiversité ; et de quantifier les flux de services et d’évaluer les avantages qui en résultent en termes de différents critères monétaires et non monétaires.
Le temps nécessaire à la mise en œuvre du processus dépend du degré d'engagement des parties prenantes, de la collecte, de la préparation et de l'analyse des données. La mise en œuvre de l'outil prend environ une à deux semaines. Des guides d'utilisation, des instructions de modélisation et des études de cas sont disponibles en ligne.
Une connaissance de la modélisation des services écosystémiques est un atout. Il n'est pas nécessaire d'acquérir et de maîtriser un logiciel SIG ou de modélisation commercial, car toutes les fonctions sont gérées à distance et restituées à l'utilisateur via une interface web. La prise en main de l'outil prend environ deux à trois semaines.
L'ouvrage « Évaluer les coûts et les avantages des options d'adaptation : un aperçu des approches » présente différentes approches et méthodologies d'évaluation des coûts et des avantages des options d'adaptation au changement climatique, et partage les meilleures pratiques et les enseignements tirés. Il comprend diverses études de cas illustrant les méthodes et options d'évaluation de l'adaptation.
Développer le rôle et l'objectif de l'évaluation des coûts et des avantages des options d'adaptation dans le processus d'adaptation. Présenter un éventail de questions méthodologiques clés et expliquer les approches d'évaluation les plus couramment utilisées. Décrire les enseignements tirés et les bonnes pratiques, fournir un glossaire des termes les plus couramment utilisés et une bibliographie de ressources et de références utiles.
Le temps nécessaire à la réalisation d'une analyse coûts-avantages dépend de l'étendue des données et de l'analyse. Logiciel requis : Microsoft Excel.
Une expertise économique et des compétences en matière d’analyse coûts-avantages sont requises.
ADAPT est un outil logiciel multisectoriel permettant d'évaluer les projets de développement dans les zones potentiellement sensibles au changement climatique. Cet outil rassemble des bases de données climatiques et des évaluations d'experts sur les menaces et les opportunités liées à la variabilité et au changement climatiques, et se concentre principalement sur l'agriculture, la biodiversité, les infrastructures rurales et les zones côtières.
Sensibiliser à l’importance/pertinence de l’adaptation au changement climatique dans la planification des projets ; examiner les projets existants en fonction des risques potentiels liés au changement climatique ; fournir des conseils sur la manière de concevoir des options alternatives pour minimiser les risques.
Fonctionne sur MS Excel.
Nécessite des compétences informatiques minimales. Le matériel et les logiciels
Guider l'utilisateur tout au long du processus de sélection. Une formation en ligne est également proposée.
Atlantis est un modèle écosystémique qui prend en compte tous les aspects des écosystèmes marins – biophysiques, économiques et sociaux. Initialement axé sur le monde biophysique, puis sur la pêche, il a évolué pour être utilisé pour de multiples usages et questions climatiques. Atlantis est un modèle biogéochimique déterministe d'ensemble de l'écosystème. Sa structure globale repose sur l'approche d'évaluation des stratégies de gestion (MSE), qui comprend un sous-modèle (ou module) pour chacune des principales étapes du cycle de gestion adaptative.
Évaluer les hypothèses sur la réponse de l’écosystème, comprendre les impacts cumulatifs des activités humaines et classer les grandes catégories d’options de gestion.
Le temps nécessaire pour entreprendre le processus dépend de la portée de l’initiative, de l’étendue de la collecte, de la préparation et de l’analyse des données.
Une gamme d’expertise sera nécessaire pour accomplir des tâches telles que la collecte de données et l’analyse des entrées/résultats.
La biodiversité dans l'évaluation d'impact (EIAI) définit les principes visant à promouvoir une évaluation d'impact (EI) « incluant la biodiversité », notamment l'évaluation d'impact environnemental (EIE) pour les projets et l'évaluation environnementale stratégique (EES) pour les politiques, plans et programmes. Des principes directeurs et des principes opérationnels sont également présentés. Ces principes fournissent des orientations générales sur la manière d'intégrer la biodiversité dans les évaluations d'impact.
Aider à la prise en compte des impacts sur la biodiversité au niveau des projets, programmes, plans et politiques en utilisant les cadres d’évaluation de l’impact sur l’environnement (EIE) et d’évaluation environnementale stratégique (EES).
Le temps nécessaire pour entreprendre le processus dépend de l’étendue de la collecte, de la préparation et de l’analyse des données.
Une gamme d’expertise sera nécessaire pour accomplir des tâches telles que la collecte de données et l’analyse des entrées/résultats.
Les lignes directrices volontaires sur la biodiversité dans l’évaluation d’impact fournissent un aperçu des connaissances minimales requises pour aborder la biodiversité dans l’évaluation d’impact et présentent des lignes directrices pour une évaluation d’impact inclusive de la biodiversité.
Aider à la prise en compte des impacts sur la biodiversité au niveau des projets, programmes, plans et politiques en utilisant les cadres d’évaluation de l’impact sur l’environnement (EIE) et d’évaluation environnementale stratégique (EES).
Le temps nécessaire pour entreprendre le processus dépend de l’étendue de la collecte, de la préparation et de l’analyse des données.
Une gamme d’expertise sera nécessaire pour accomplir des tâches telles que la collecte de données et l’analyse des entrées/résultats.
Le rapport « Indicateurs de biodiversité pour le suivi des impacts et des actions de conservation » présente une méthodologie d'élaboration d'indicateurs à l'échelle du site afin de suivre les impacts positifs et négatifs significatifs sur la biodiversité. Bien que destinée aux exploitants pétroliers et gaziers, cette approche est applicable à divers contextes et fournit des orientations pour la définition des indicateurs. Elle ne présente pas de liste d'indicateurs, mais se concentre sur la méthode d'élaboration des indicateurs.
Aider les utilisateurs à comprendre et à appliquer le processus de développement des indicateurs.
Aucun logiciel/ressource supplémentaire n'est nécessaire.
Aucune compétence spécifique spécifiée.
L'outil d'aide à l'adaptation est un outil de planification en ligne qui illustre l'impact des mesures sur plusieurs paramètres urbains, tels que la capacité de rétention d'eau créée, la réduction des débits de pointe, la réduction du stress thermique et l'amélioration de la qualité des eaux pluviales. Il fournit des chiffres clés sur la performance, les coûts et les co-bénéfices. Il fait partie d'une boîte à outils d'aide à l'adaptation plus large, qui couvre la sélection des sites, le classement des mesures, la formulation des plans d'adaptation (où l'AST s'intègre), l'amélioration créative et l'évaluation.
Aider l’utilisateur à sélectionner la meilleure combinaison de mesures d’adaptation et à produire un plan d’adaptation adapté aux besoins des parties prenantes locales.
Le temps nécessaire pour entreprendre le processus/les évaluations dépend de l’étendue de la collecte, de la préparation et de l’analyse des données.
Une gamme d’expertise sera nécessaire pour accomplir des tâches telles que la collecte de données et l’analyse des entrées/résultats.
Les solutions logicielles Blue Green Dream (BGD) sont une suite d'outils développée par le projet Blue Green Dream, ainsi qu'un guide des solutions Blue Green et des outils de modélisation et méthodologiques, pour diverses applications Blue Green. Celles-ci concernent la planification, la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance des systèmes d'eau urbains (bleus) et des espaces verts urbains pour soutenir l'adaptation. Ensemble, ces outils constituent un ensemble de solutions :
– Boîte à outils BGD – Système d'aide au choix
– Matrice d'évaluation des solutions BG
– BGD E-Learning
– Façade Verte BGD, Module BIM
– Citerne intelligente BGD
– Système de surveillance intégré BGD (IMS)
Fournir à l’utilisateur des informations et des outils pour évaluer et mettre en œuvre des options d’adaptation bleu-vert pour les zones urbaines.
Le temps nécessaire à la réalisation du processus/des évaluations dépend de l'ampleur de la collecte, de la préparation et de l'analyse des données. Des services de conseil sont proposés.
Selon les outils utilisés, une gamme d’expertise sera nécessaire pour accomplir des tâches telles que la collecte de données et l’analyse des entrées/résultats ; par exemple, celles-ci pourraient inclure des compétences informatiques de base, des compétences en SIG, une expérience en planification et gestion de l’environnement, ainsi qu’une connaissance des impacts et des politiques du changement climatique et de l’environnement bâti.
Le Climate Adaptation Knowledge Exchange (CAKE) a été fondé par EcoAdapt et Island Press en juillet 2010 et est géré par EcoAdapt. Son objectif est de constituer une base de connaissances partagée pour la gestion des systèmes naturels et bâtis face à un changement climatique rapide. Il vise également à contribuer à la création d'une communauté de pratique innovante. Il aide les utilisateurs à dépasser les contraintes de temps et la masse innombrable d'ouvrages, de documents et d'articles : en examinant et en organisant clairement les meilleures informations disponibles ; en créant une communauté via une plateforme en ligne interactive ; en créant un répertoire de praticiens pour partager leurs connaissances et leurs stratégies ; et en identifiant et en expliquant les outils de données et les informations disponibles sur d'autres sites. Il se compose principalement de quatre éléments interdépendants : études de cas ; bibliothèque virtuelle ; répertoire ; et outils.
Construire une base de connaissances partagée pour la gestion des systèmes naturels et bâtis face au changement climatique rapide.
Aucune ressource supplémentaire n'est requise.
Aucune compétence/formation supplémentaire n'est requise.
Capnet est une plateforme d'information en ligne proposant du matériel de formation présentant la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) comme outil d'adaptation au changement climatique. Elle propose également des liens vers des centres de ressources nationaux proposant des services d'éducation, de formation, de recherche et de conseil dans le domaine de l'eau.
Fournir un réseau international pour le développement des capacités en matière de gestion de l’eau.
Aucun logiciel/ressource supplémentaire n'est nécessaire.
Aucune compétence spécifique spécifiée.
Que vous travailliez pour CARE, ou avec l'un de nos partenaires, ou pour toute autre organisation impliquée dans le changement climatique et la résilience, l'objectif de cette plateforme est d'élargir et d'approfondir vos connaissances et votre compréhension du changement climatique, de ses causes et de ses conséquences.
Nos ressources s’appuient sur les connaissances et l’expérience existantes et offrent de nouvelles compétences et de nouveaux outils qui permettent aux participants de mieux aborder la complexité du problème.
Les ressources d’apprentissage sont directement basées sur les 20 années d’expérience de CARE en matière de résilience, d’adaptation communautaire, de plaidoyer climatique et sur nos propres efforts pour devenir une organisation intelligente face au climat.
Il existe trois types différents de ressources d’apprentissage disponibles :
Les COURS EN LIGNE sont des cours gratuits et à votre rythme, accessibles 24h/24 et 7j/7 pour les personnes à l'intérieur et à l'extérieur de CARE.
Les PARCOURS D'APPRENTISSAGE sont des formations en ligne interactives par abonnement qui combinent des cours en ligne, des échanges entre pairs et du coaching.
PACKS DE FORMATEURS pour formateurs et animateurs contenant du matériel de formation modifiable sur la résilience et le changement climatique ainsi que des conseils de facilitation.
5 heures (cours en ligne), 1 jour (packs de formation), 2 ans (parcours d'apprentissage)
Cette publication présente et met en lumière les expériences utilisant des solutions fondées sur la nature (NbS) pour renforcer la résilience climatique dans trois chaînes de montagnes : les Andes en Amérique du Sud, l'Himalaya en Asie et le mont Elgon en Afrique de l'Est.
Son objectif principal est de fournir des informations pratiques sur ces expériences afin d'informer les praticiens des SfN, les décideurs, les concepteurs et gestionnaires de projets, les chercheurs et les communautés locales. Les expériences illustrées dans cette publication comprennent des témoignages de première main et des connaissances de responsables de projets ainsi que des témoignages de bénéficiaires locaux dans les trois pays phares (Népal, Pérou et Ouganda) et les trois pays d'expansion (Bhoutan, Colombie et Kenya) afin de montrer les mesures d'EbA qui ont conduit à une résilience climatique accrue, à une gestion adaptative des terres et à la sécurisation des ressources en eau pour ces six communautés de montagne.
Il est temps de lire et de comprendre les méthodes mises en œuvre.
Aucune compétence ou formation particulière n'est requise, seulement une compréhension de l'anglais.
La méthodologie « Changement de marées : Méthodologie d’adaptation au climat pour les aires protégées » (CAMPA) décrit une approche d’élaboration de mesures d’adaptation au climat dans les aires protégées côtières et marines (APMC). Elle combine des approches écosystémiques et communautaires de l’adaptation et utilise une approche participative visant à établir un consensus entre les parties prenantes sur les actions nécessaires pour faire face aux impacts actuels et potentiels du changement climatique. La méthodologie est décrite en détail et trois études de cas résument les enseignements tirés de ses tests sur le terrain dans six APMC en Colombie, à Madagascar et aux Philippines. Elle utilise une série de fiches de travail pour simplifier le processus de réalisation et peut être appliquée soit dans le cadre d’un processus détaillé et basé sur des données qui prendra du temps, soit dans le cadre d’une évaluation plus courte, plus rapide mais moins rigoureuse pour faciliter la prise de décisions de gestion. Les études de cas décrivent l’application de la CAMPA dans les aires protégées nationales de Gorgona et de Sanquianga en Colombie ; les aires marines protégées de Nosy Hara et d’Ambodivahibe dans le nord de Madagascar et deux petites aires protégées de la cité-jardin insulaire de Samal aux Philippines.
Fournir aux utilisateurs une approche pour développer des mesures d’adaptation au climat dans les aires protégées côtières et marines (APCM).
Le manuel s'appuie sur de nombreux documents de référence et des fiches de travail sont fournies au format électronique pour faciliter leur utilisation. Le temps nécessaire à la mise en œuvre du processus dépend du degré d'implication des parties prenantes, de la collecte, de la préparation et de l'analyse des données.
Des compétences variées seront nécessaires pour accomplir des tâches telles que la collecte de données et l'analyse des données d'entrée et de sortie. Une expérience en matière d'engagement des parties prenantes, d'écosystèmes et de leur évaluation, ainsi que de planification serait un atout.
La boîte à outils Cities4Forests propose un ensemble d'outils pratiques du monde entier pour aider les villes à intégrer les forêts, les arbres et les infrastructures vertes dans leurs décisions, leur planification et leurs investissements. Ces outils couvrent un large éventail de sujets, de la valorisation des arbres et des forêts à la maximisation des bénéfices clés (tels que la biodiversité, la santé, l'eau et le carbone), en passant par la planification et la gestion de projets forestiers à l'intérieur et à l'extérieur de leurs frontières.
Aider les villes dans leurs efforts pour valoriser les arbres et les forêts, maximiser leurs avantages et planifier et gérer les projets liés aux forêts.
Aucun logiciel/ressource supplémentaire n'est nécessaire.
Aucune compétence spécifique spécifiée.
L'Indice de biodiversité urbaine est un outil d'auto-évaluation de la biodiversité urbaine. Il s'agit du seul indice de biodiversité spécifiquement dédié aux villes. Il a été développé par des experts du monde entier, dont des instituts de recherche universitaire, des responsables locaux expérimentés et des organisations reconnues spécialisées dans la biodiversité et les services écosystémiques en milieu urbain.
Aider les villes à mieux comprendre comment elles peuvent améliorer leurs efforts de conservation de la biodiversité au fil du temps ; servir de plate-forme publique sur laquelle des exercices de sensibilisation à la biodiversité peuvent être lancés ; servir de portail entre les différents départements de la gouvernance municipale, les universitaires, les ONG et le public, en encourageant la communication, des réseaux plus solides et une plus grande coopération, grâce à la collecte de données et à des objectifs partagés, ce qui se traduit par de meilleurs résultats politiques.
Les villes doivent réaliser une première mesure de référence, identifier les priorités politiques en fonction de ces mesures, puis effectuer un nouveau suivi à intervalles réguliers. Le temps nécessaire à la mise en œuvre de ce processus dépend de l'ampleur de la collecte, de la préparation et de l'analyse des données.
Des connaissances de base sur le profil de la ville et les indicateurs sont requises, ainsi que des compétences mathématiques et analytiques de base.
CityStrength est un diagnostic rapide de la résilience à divers chocs, dont le changement climatique. Il s'agit d'une évaluation qualitative développée avec le soutien du Dispositif mondial pour la réduction des catastrophes et le relèvement (GFDRR). Elle comporte cinq étapes et s'articule autour de modules sectoriels couvrant des sujets spécifiques à la ville. CityStrength évalue d'abord la résilience sectorielle, puis compile les résultats pour identifier les interrelations qui déterminent la résilience de la ville. Le résultat final est une liste priorisée d'actions structurelles et non structurelles visant à renforcer la résilience.
Aider les villes à renforcer leur résilience face à divers chocs.
Le processus nécessite de 2 à 6 mois. Aucun logiciel ni ressource supplémentaire n'est requis pour utiliser cet outil.
Une gamme d’expertise sera nécessaire pour accomplir des tâches telles que la collecte de données et l’analyse des entrées/résultats.
Le Climate Canvas, inspiré du Business Model Canvas, est un outil de planification innovant, soigneusement conçu pour les petites et moyennes entreprises (PME). Forte de ses neuf piliers essentiels, la méthodologie aborde de manière exhaustive les menaces liées au changement climatique, les complexités de la chaîne d'approvisionnement, les risques de marché et les défis opérationnels, facilitant ainsi la planification stratégique et les mesures d'adaptation. Le Climate Canvas a notamment évolué vers une application web dynamique dotée de fonctionnalités d'IA, améliorant l'accessibilité et fournissant aux entreprises des informations pertinentes pour gérer la complexité des risques et des opportunités liés au climat.
Les principaux objectifs et finalités de la méthodologie Climate Canvas sont les suivants :
Évaluation complète des risques :
Le Climate Canvas est un outil de planification stratégique qui facilite une évaluation approfondie des risques liés au changement climatique auxquels sont confrontées les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME). Il identifie systématiquement les menaces liées au changement climatique, les vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement, les risques opérationnels et la dynamique du marché.
Planification holistique du changement climatique :
En s'appuyant sur neuf piliers clés, la méthodologie garantit une approche globale de la planification climatique. Elle couvre les engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre, les indicateurs clés de performance et les mesures d'atténuation et d'adaptation. Cette perspective globale permet aux entreprises de relever les défis climatiques à différents niveaux d'activité.
Adapté aux PME :
La méthodologie est spécifiquement conçue pour répondre aux besoins des PME, en tenant compte de leurs défis et opportunités spécifiques. Elle propose un modèle convivial d'une page qui simplifie les considérations complexes liées au climat, le rendant ainsi accessible et applicable aux petites entreprises aux ressources limitées.
Prise de décision stratégique :
Climate Canvas facilite la prise de décision éclairée en guidant les entreprises dans la formulation de stratégies d'adaptation basées sur les risques et opportunités identifiés. Il aide les organisations à prioriser les actions qui renforcent la résilience, la durabilité et la viabilité à long terme face au changement climatique.
Progrès mesurables et responsabilité :
L'intégration d'indicateurs clés dans la méthodologie permet aux entreprises de suivre et de mesurer leurs progrès dans la mise en œuvre des initiatives de lutte contre le changement climatique. Cela favorise la responsabilisation et la transparence, permettant aux parties prenantes d'évaluer l'efficacité des mesures prises.
Planification financière et réalisation des avantages :
Cette méthodologie facilite la planification financière en définissant les dépenses nécessaires à la mise en œuvre de mesures liées au climat. Parallèlement, elle aide les entreprises à identifier les avantages financiers potentiels, favorisant ainsi une approche équilibrée entre durabilité et viabilité économique.
Flexibilité et adaptabilité :
Reconnaissant la nature dynamique du changement climatique, la méthodologie Climate Canvas est conçue pour être flexible et adaptable. Elle s'adapte à l'évolution des risques, aux opportunités émergentes et aux changements de l'environnement économique, offrant aux entreprises un cadre résilient pour une amélioration continue.
Le temps et les ressources nécessaires à l'utilisation efficace de la méthodologie Climate Canvas dépendent de la taille et de la complexité de l'entreprise, ainsi que de la profondeur d'analyse souhaitée. Généralement, pour une petite ou moyenne entreprise (PME), l'utilisation de Climate Canvas implique un processus de planification stratégique pouvant s'étendre sur plusieurs semaines afin de garantir la rigueur et l'exactitude de l'analyse. Ce processus comprend la collecte de données, la consultation des parties prenantes et des évaluations complètes des risques.
Les ressources nécessaires comprennent principalement du personnel dédié à la collecte et à l'analyse des données, ainsi qu'un accès aux sources d'information pertinentes. Des ressources financières sont également nécessaires pour mettre en œuvre les mesures d'atténuation et d'adaptation identifiées.
Cependant, la méthodologie Climate Canvas a été optimisée pour plus d'efficacité, et son modèle convivial d'une page simplifie le processus. Grâce à des avancées telles que son application web dotée de fonctionnalités d'IA, les entreprises peuvent exploiter des informations pertinentes, réduisant ainsi potentiellement le temps nécessaire à l'analyse et à la prise de décision.
L'utilisation efficace de la méthodologie Climate Canvas nécessite un ensemble diversifié de compétences et de formations pour garantir une approche globale de la planification de la résilience au changement climatique. Les utilisateurs doivent posséder des connaissances fondamentales sur le changement climatique et ses implications, ainsi qu'une maîtrise des principes de stratégie et de planification d'entreprise pour intégrer harmonieusement les considérations climatiques aux stratégies organisationnelles globales. De solides compétences en analyse et recherche de données sont essentielles pour interpréter les données climatiques et évaluer les impacts potentiels sur les chaînes d'approvisionnement et les opérations. De plus, la familiarisation avec les fonctionnalités spécifiques de l'outil Climate Canvas, notamment son application web dotée de fonctionnalités d'IA, nécessite une formation pour en optimiser le potentiel et garantir une navigation efficace.
Bien que la méthodologie Climate Canvas soit conçue pour être conviviale, une formation continue est encouragée pour en améliorer l'efficacité. Celle-ci peut inclure des sessions de navigation dans l'outil, de collaboration interdisciplinaire et d'accès aux ressources d'assistance fournies par les développeurs.
La Boîte à outils d'adaptation au changement climatique pour les aires marines et côtières protégées a été créée pour simplifier, accélérer et faciliter la planification de l'adaptation au changement climatique pour les gestionnaires d'aires marines protégées. Elle contient des outils qui aident les gestionnaires d'aires protégées à évaluer la vulnérabilité de leurs sites au changement climatique, à identifier des stratégies d'adaptation appropriées et à se familiariser avec ces stratégies grâce à des études de cas, des rapports et d'autres ressources.
Ce document guide les praticiens des AMP à travers un processus de planification de base de l'adaptation au changement climatique à l'aide de la Boîte à outils d'adaptation au changement climatique. Cette boîte à outils contient des outils pour aider les praticiens des AMP à évaluer la vulnérabilité de leurs sites au changement climatique et à identifier les stratégies d'adaptation appropriées. Le module de formation fournit un cadre et des exercices de formation pour soutenir l'utilisation réussie de la Boîte à outils d'adaptation au changement climatique pour la planification de l'adaptation dans les aires marines et côtières protégées.
L'approche CCAIRR décrite au chapitre 8 de la publication comprend cinq composantes principales : l'évaluation et le renforcement des capacités ; l'analyse des données et des outils de connaissance ; l'évaluation rapide des risques ; l'intégration ; et le suivi et l'évaluation. La publication contient également six études de cas pour illustrer cette approche.
Rendre les projets de développement à l’épreuve du climat et permettre l’intégration des considérations liées au changement climatique dans les plans nationaux de développement stratégique.
Le temps nécessaire pour entreprendre le processus dépend de la portée de l’initiative, de l’étendue de la collecte, de la préparation et de l’analyse des données.
Une gamme d’expertise sera nécessaire pour accomplir des tâches telles que la collecte de données et l’analyse des entrées/résultats.
Le CEDRA est un processus qui fournit des conseils étape par étape pour réaliser une évaluation stratégique des risques. Il aide les agences travaillant dans les pays en développement à évaluer les risques environnementaux et à intégrer l'adaptation à leurs activités de développement et de réduction des risques de catastrophe.
Pour aider l'utilisateur à comprendre les expériences des communautés face aux changements environnementaux ; comprendre la science du climat et de l'environnement ; évaluer les impacts climatiques et environnementaux probables sur les communautés et les projets ; hiérarchiser ces impacts ; identifier les moyens d'adapter les projets et, dans certains cas, identifier les nouveaux projets nécessaires ; élaborer un plan d'action pour que les projets et les communautés s'adaptent aux changements climatiques et environnementaux.
Le temps nécessaire à la mise en œuvre du processus dépend de la portée de l'initiative, des analyses associées, du nombre d'acteurs impliqués et de la quantité d'informations complémentaires/secondaires disponibles dans la zone cible. Les délais suivants sont indicatifs : 1 à 3 mois pour la réalisation de l'évaluation ; 2 à 4 jours pour le partage des conclusions et des recommandations avec les communautés/acteurs ; 18 mois pour l'intégration des changements. Aucun logiciel ni ressource supplémentaire n'est requis.
CEDRA a été conçu pour être utilisé par des personnes expérimentées dans la planification et la gestion de projets de développement. Un atelier de renforcement des capacités visant à former les participants au processus CEDRA et à le planifier peut durer de 2 à 6 jours.